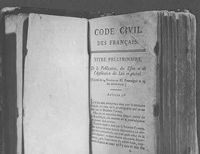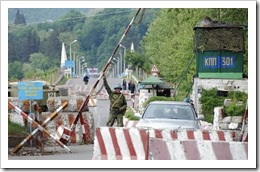Le débat politique fonctionne des clichés que personne ne prend la peine de discuter. Par exemple l’idée qu’accorder plus de pouvoirs au parlement reviendrait à « démocratiser » nos institutions.
Le débat politique fonctionne des clichés que personne ne prend la peine de discuter. Par exemple l’idée qu’accorder plus de pouvoirs au parlement reviendrait à « démocratiser » nos institutions.
Le pouvoir exécutif est perçu comme étant toujours sujet aux excès, tenté d’attenter aux libertés et de sombrer dans l’arbitraire. Le pouvoir législatif serait, lui, plus raisonnable, plus mesuré, plus sage, plus représentatif de la population.
On voit mal en quoi un Jean François Copé ou un Jean Marc Ayrault serait par essence, plus malin, plus sage ou plus en phase avec le pays, qu’un ministre ou même qu’un conseiller de l’Elysée. Mais c’est pourtant sur cette idée communément admise que s’appuie l’actuelle réforme des institutions que l’on annonce comme la plus importante depuis 1962.
L’idée qu’il est nécessaire de revaloriser les pouvoirs du parlement s’inscrit en fait dans un schéma institutionnel qui n’est pas le nôtre. Dans un régime parlementaire classique, le pouvoir procède de l’élection législative qui donne la majorité à un collectif (un parti ou une coalition), lequel délègue le pouvoir à un exécutif qu’il contrôle. Les pouvoirs du parlement sont ceux, très classiques, d’un mandant sur son mandataire. L’exécutif exerce sa mission sous le contrôle et la responsabilité du législatif, lequel dispose sur lui d’un pouvoir de révocation. Dans ce schéma, il est parfaitement logique que le parlement dispose de vrais pouvoirs d’orientation et de contrôle sur l’action publique.
 RST inaugure aujourd’hui une nouvelle rubrique sur Horizons « la Chronique des commentateurs associés » avec un article qui risque de bouleverser notre manière de penser l’économie. A n'en pas douter, il va susciter beaucoup d’interrogations et de débats dans les commentaires.
RST inaugure aujourd’hui une nouvelle rubrique sur Horizons « la Chronique des commentateurs associés » avec un article qui risque de bouleverser notre manière de penser l’économie. A n'en pas douter, il va susciter beaucoup d’interrogations et de débats dans les commentaires.